Malgré tous les discours sur les révolutions solaires et les transitions justes, une vérité définit toujours l'histoire énergétique de l'Afrique : l'accès du continent à l'électricité dépend de son accès à des capitaux abordables. Agence internationale de l'énergie (AIE) rapport, Financement de l'accès à l'électricité en Afrique (2025), pose le problème à nu : l’Afrique ne manque pas de soleil ou d’ambition, mais de financements adaptés à ses réalités.
Le paradoxe du financement
En Afrique subsaharienne, près de 600 millions de personnes restent privées d'électricité, tandis que celles qui y sont raccordées subissent souvent des approvisionnements irréguliers ou des tarifs élevés. Pourtant, l'AIE estime que l'Afrique reçoit moins d'un tiers des investissements annuels nécessaires pour atteindre l'accès universel d'ici 2030.
Les chiffres révèlent un déséquilibre structurel : bien que le continent ait besoin d'environ 1 425 à 30 milliards de livres sterling par an, les flux réels oscillent autour de 1 499 à 10 milliards de livres sterling. Il en résulte un patchwork de progrès : les villes s'illuminent tandis que les communautés rurales restent dans l'obscurité.
Le paradoxe est évident. Même si le financement climatique mondial s'accélère, le coût du capital pour les projets énergétiques africains reste jusqu'à quatre fois supérieur à celui des économies avancées. Les promoteurs locaux empruntent souvent à des taux d'intérêt de 12 à 20 %, contre 4 à 6 % sur les marchés de l'OCDE. Ce facteur à lui seul gonfle le coût de la production d'électricité et rend les objectifs d'électrification encore plus inaccessibles.
“ Réduire le coût du capital aux moyennes mondiales pourrait réduire les coûts des projets de 15 à 25 % et apporter de l’électricité à 40 millions de personnes supplémentaires ”,” L'AIE note un chiffre qui souligne à quel point c'est la finance, et non la technologie, qui constitue le véritable goulot d'étranglement de l'Afrique.
Le véritable coût de l'énergie
L'accès à l'électricité ne se limite pas à la construction de lignes ou à l'installation de panneaux ; il s'agit de pérenniser les systèmes. Pour de nombreux pays africains, l'architecture financière elle-même constitue le problème.
La plupart des projets reposent sur des prêts en devises, ce qui signifie que chaque dépréciation du naira, du cedi ou du shilling alourdit la charge de remboursement. Même lorsque des fonds concessionnels sont disponibles, les retards de décaissement et la complexité des processus d'approbation rendent leur déploiement difficile.
Parallèlement, les perceptions du risque, souvent dépassées, incitent les investisseurs internationaux à la prudence. Le rapport affirme que les primes de risque appliquées aux projets africains dépassent largement le risque réel du marché, reflétant un système financier encore façonné par des stéréotypes plutôt que par des données.
Les conséquences sont immédiates. Les développeurs de mini-réseaux réduisent leurs activités, les agences d'électrification rurale stagnent et les services publics s'endettent encore davantage. Ce qui devrait être un cercle vertueux d'investissement et de croissance se transforme en un cercle vicieux de sous-financement, d'inefficacité et de pertes d'opportunités.
Finances publiques contre capitaux privés
Qui devrait payer pour l’accès universel et à quelles conditions ?
Le rapport de l’AIE souligne un fossé grandissant entre le dynamisme du secteur privé et la responsabilité du secteur public.
Les investisseurs privés ont apporté des innovations aux systèmes solaires domestiques, au stockage sur batterie et aux micro-réseaux. Cependant, ils privilégient les marchés à revenus élevés et à faible risque, ainsi que les zones urbaines ou périurbaines où les utilisateurs peuvent payer. Le financement public, quant à lui, se retrouve contraint de soutenir des environnements fragiles et peu rentables : villages isolés, régions touchées par des conflits et communautés pauvres qui ont le plus besoin d'électricité.
Cette géographie inégale de la finance reflète une inégalité plus profonde. Lorsque le secteur privé domine l'extrémité rentable du spectre et que les institutions publiques absorbent le risque, l'accès universel devient une cible mouvante.
Le rapport préconise une “ combinaison stratégique de capitaux publics et privés ”, qui oriente les financements concessionnels vers la réduction des risques, et non vers de simples subventions. Des instruments tels que les garanties de première perte, la couverture en monnaie locale et les fonds de développement régional pourraient contribuer à rééquilibrer le système.
“ Réduire les risques ne signifie pas transférer le risque sur le public. ” un régulateur africain de l'énergie l'a déclaré à l'AIE lors de consultations. “ Cela doit impliquer la création d’institutions qui gèrent les risques de manière collective. ”
Genre et inclusion : la dimension manquante
La précarité énergétique n'est pas neutre en termes de genre. Les femmes sont les plus touchées par les pénuries d'électricité, du travail de soins non rémunéré à la perte de revenus dans les entreprises informelles. Pourtant, l'AIE constate que les entreprises dirigées par des femmes sont confrontées à un déficit de financement de 14 milliards de livres sterling (1,4 milliard de livres sterling) dans les secteurs de l'accès à l'énergie.
Les femmes entrepreneures qui gèrent des réseaux de distribution solaire, des start-ups de cuisson propre ou des mini-réseaux communautaires manquent souvent de garanties, d'antécédents de crédit ou d'accès aux prêts en devises. L'absence de financement prenant en compte la dimension de genre perpétue l'exclusion, et non l'autonomisation.
Combler ce fossé exige plus qu'une inclusion symbolique. Cela nécessite des lignes de crédit dédiées, des achats sensibles au genre et des partenariats avec des institutions de microfinance. Comme le souligne l'AIE, combler le déficit de financement des femmes pourrait générer des gains de productivité qui se répercuteraient sur l'ensemble des économies locales.
Réduire les risques sans s'endetter
La recommandation la plus urgente de l’AIE est d’une simplicité trompeuse : réduire les coûts d’emprunt sans augmenter la dette.
Cela signifie passer d’instruments centrés sur la dette à des subventions, des garanties et des modèles mixtes qui attirent l’investissement privé sans piéger les gouvernements dans des cycles de remboursement.
Par exemple, le rapport prévoit que des subventions d'offre couvrant 30 % des coûts des mini-réseaux et 50 % des systèmes solaires domestiques pourraient étendre l'accès à l'énergie à 110 millions de personnes. Point crucial, cela laisserait une marge de manœuvre aux opérateurs privés, mais avec des conditions de participation plus équitables.
Le financement en monnaie locale constitue un autre pilier. Si les banques régionales peuvent prêter en naira, en cedi ou en shilling, les promoteurs peuvent couvrir le risque de change à la source. La plateforme de financement mixte en monnaie locale proposée par la Banque africaine de développement, ainsi que des initiatives de Afrique50 et la Société financière africaine, constituent des pas dans cette direction.
Ces outils redéfinissent ce que signifie la réduction des risques : non pas transférer le risque, mais le transformer.
La politique du pouvoir
Sous les feuilles de calcul se cache une question d’économie politique : qui contrôle le financement de l’énergie ?
Une grande partie de la transition énergétique de l’Afrique reste façonnée par des agendas extérieurs, que ce soit par le biais de prêts conditionnels, de projets pilotés par des donateurs ou de contrats libellés en euros ou en dollars.
Cette dépendance a un coût réel. Lorsque les taux d'intérêt mondiaux augmentent, l'avenir énergétique de l'Afrique devient du jour au lendemain plus coûteux. Comme l'a indiqué un analyste de l'AIE. Transition énergétique en Afrique, “ La région la plus pauvre du monde paie effectivement le prix le plus élevé pour ses ambitions les plus propres. ”
Inverser cette équation nécessitera plus que des innovations au niveau des projets. Cela exige une souveraineté financière régionale, des institutions capables de mobiliser l'épargne nationale, d'émettre des obligations vertes et de réinvestir les excédents localement. La section du rapport consacrée à “ Construire l’architecture financière africaine ” est un appel à renforcer la résilience, pas seulement les infrastructures.
Leçons pour les décideurs politiques
- Réduire le coût du capital. Aligner la stabilité macroéconomique, les notations de crédit et les réformes de gouvernance avec la confiance des investisseurs.
- Utiliser le financement concessionnel de manière stratégique. Orienter les subventions vers la réduction des risques et l’inclusion sociale, et non vers des subventions perpétuelles.
- Donnez la priorité à la transparence des données. Des données fiables sur le secteur de l’énergie réduisent le risque perçu et améliorent la précision des prix.
- Intégrer le genre. Chaque fonds majeur devrait inclure des critères tenant compte de la dimension de genre dans son cadre d’investissement.
- Développer les marchés de capitaux régionaux. Les obligations vertes en monnaie locale et les garanties régionales peuvent atténuer la volatilité mondiale.
Ensemble, ces étapes forment l’échafaudage de ce que l’AIE appelle “ un accès à l’énergie abordable, juste et durable ”.”
Une voie à suivre
L'avenir énergétique de l'Afrique ne dépendra pas uniquement de la technologie. Il dépendra de la structure financière, de la prise de risque et de la monnaie qui compte. Financer l'accès à l'électricité en Afrique Le rapport se termine par un rappel brutal : sans nouveaux modèles, l’objectif d’accès universel de 2030 sera repoussé à 2045.
L'implication morale est impossible à ignorer. L'électricité n'est pas une œuvre de charité ; c'est une infrastructure au service de la dignité. Son financement équitable est à la fois une nécessité de développement et un impératif de justice.
Si l’Afrique parvient à mobiliser les capitaux locaux, à rationaliser les financements concessionnels et à enfin réduire le coût de l’énergie, le continent pourra peut-être encore éclairer son avenir selon ses propres conditions.
Suivre Transition énergétique en Afrique pour plus de mises à jour :
![]()
![]()
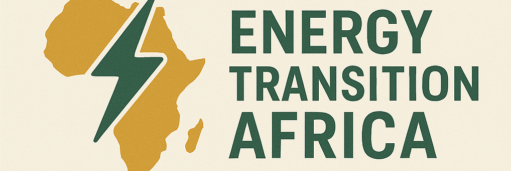

Ping : La promesse d'une énergie propre en Afrique : entre progrès politiques et patience des populations - Transition énergétique Afrique